 |
| La rue, est-ce bien leur place ? |
Premières amours…
Ces constats, je me vois aujourd’hui contraint de les refaire, à la suite de ce que je pourrais qualifier de séisme professionnel. Je travaille en effet depuis bientôt 11 ans comme agent de sécurité. De ces années, j’en ai passé trois à titre d’agent de service privé, à mes débuts, avec un bref retour à ce poste il y a deux ans et demi, à la fermeture de l’usine où je travaillais alors.
Un agent de service privé est un type particulier d’agent de sécurité, très méconnu, comme la situation générale des psychiatrisés en milieu hospitalier. Ces employés en civil se fondent dans la faune des infirmiers, médecins, préposés et autres intervenants. Ils sont attachés à la sécurité de patients affectés par toute la gamme des problématiques de santé mentale imaginable : dépressifs, suicidaires, Alzheimer, autistiques, bipolaires, psychotiques, schizophrènes, et j’en passe. Ces agents doivent protéger ces pauvres âmes contre elles-mêmes, mais aussi assurer la sécurité des autres employés en contact avec eux et… se protéger eux-mêmes, bien sûr.
 |
| Voilà un endroit où je ne croyais plus travailler... |
C’est vers la fin novembre, alors que je voguais sur un fleuve tranquille, toujours au même poste de nuit, où je devais assurer la sécurité des bâtiments d’un client de l’agence qui m’emploie, que le destin allait me réserver un tour de sa façon. Mes collègues et moi apprenions sans préavis que ledit client changeait d’agence de sécurité, tout en nous proposant toutefois de rester en poste.
Aussitôt, nous nous sommes réunis pour discuter de la question, puisque c’était au prix de notre ancienneté que nous aurions pu rester en place, au sein d'une nouvelle compagnie, chez un client dont l’avenir même restait incertain, pour diverses raisons, à moyen terme. À contrecœur, nous avons choisi de préserver notre ancienneté, donc de rester auprès de notre employeur, sous contrat avec le milieu hospitalier mauricien, et ainsi de retourner sur appel auprès de patients psychiatrisés, loin du site où nous nous sentions si à l’aise, dans l’attente d’un hypothétique poste permanent.
La vie, c’est si fragile…
Heureusement, nous ne devions pas tarder à constater que l’ancienneté a ses avantages : nous avions des horaires à court terme, mais des horaires tout de même. Autre « bon côté » : je me suis vu suivre certains patients plus longtemps que par le passé, ayant ainsi la chance relative d’établir un contact, si l’on peut dire, plus constant avec eux. Ces patients avaient ceci en commun que chacun avait eu une vie normale, une conjointe, des enfants, une situation, un cercle d’amis. En avais-je vu déjà de ces hommes et de ces femmes, jadis père ou mère, avocat, médecin, notaire, devenus on ne sait comment des loques humaines, sans avenir, avec presque pas de présent, et plus qu’un mince fil les liant à leur passé, de plus en plus ténu, au fur et à mesure que leur maladie progressait, parfois jusqu'au trépas.
« Il y a deux mois encore, ce patient était tout aussi lucide que vous en moi, autonome en résidence », me disait récemment une infirmière de l’un d’eux, qui ne communiquait plus que par grognements sonores répétitifs pour faire comprendre qu’il voulait passer de la chaise adaptée, où il était installé, vers son lit. Le pauvre homme ne pouvait plus marcher sans assistance, pas plus que d’aller aux toilettes. Il arrivait encore à manger par ses propres moyens, mais il fallait lui retirer ses assiettes de plastique pour qu’il ne tente pas de les mastiquer. Ces patients deviennent souvent agressifs, voire violents, quand ils se sentent contrariés. On peut fréquemment en obtenir une collaboration insoupçonnée, ne serait-ce qu’en leur parlant doucement, preuve d’une vague réceptivité à un peu d’humanité, de sollicitude, chez ces êtres désertés d’eux-mêmes.
 |
| Tous les patients n'ont pas l'air aussi radieux... |
Un autre de ces patients, véritable armoire à glace âgée de 70 ans, s’était démarqué par un nombre record de codes blancs (appellation qui désigne une intervention immédiate de tout le personnel avoisinant en vue d’immobiliser un patient devenu violent et incontrôlable). Il ne lui restait plus dans sa chambre que son matelas et ses draps, le reste du mobilier et des objets usuels ayant passé par-dessus la barrière qui lui bloquait l’accès au corridor. Le septuagénaire, incapable d’une conversation suivie, donnait l’impression d’un vieux poupon en couche-culotte, ne se déplaçait la plupart du temps qu’à quatre pattes, pouvait uriner sans préavis sur le plancher de sa chambre, et se révélait si instable sur ses jambes qu’il fallait faire appel à un préposé pour qu’à deux, nous puissions l’amener aux toilettes. Je devais constamment veiller à ce qu’il ne tombe pas.
J’avais réussi à développer un semblant de relation avec cette triste épave, qui ne pouvait plus faire un pas des toilettes au lit, ou vice-versa, sans me demander de lui tenir la main. Quelque chose comme un lien de confiance s’était tissé de sa part envers moi, entrevu lors d'un vague sourire, d'un haussement d’épaule gêné, au point où j’arrivais à le faire collaborer avec des infirmières alors qu’il leur opposait d’abord un refus catégorique. Le personnel infirmier, qui pourtant en avait vu d’autres, ne pouvait s’empêcher d’émettre des commentaires désolés, hochant la tête, tellement le spectacle, si l’on peut dire, d’une telle ruine, les ébranlait. « On n’est pas équipés pour un tel patient ! » était le constat qui revenait le plus souvent. En effet, mais qui l’est, désormais ?
 |
| La boxe, vraiment le noble art ? |
Récemment, j’ai eu à m’occuper plusieurs jours d’un ancien boxeur amateur, qui avait poursuivi ses activités sportives d’une façon inappropriée jusqu’à l’hôpital où il avait échoué. Il avait en effet expédié au tapis un préposé d’un mètre quatre-vingt-dix, fracturé la mâchoire d’un agent de sécurité, fait sauter une canine à une infirmière, cela mis à part d’autres exploits qui, heureusement, n’avaient laissé aucune séquelle. Si je n’étais pas déjà persuadé que la boxe reste un sport aussi primitif que meurtrier, l’état de ce patient aurait suffi à m’en convaincre. Incapable de finir une phrase, l’homme en était réduit à la compléter par des sifflements ou des sons inintelligibles, articulés parfois avec un regard impuissant.
Pour des raisons évidentes, je devais constamment observer une distance respectable de sa gauche meurtrière, maintenir doucement mais fermement ses poignets tandis que les infirmières le médicamentaient ou que les préposés lui changeait sa couche-culotte, et continuer de contrôler ses poings le temps que nous marchions dans des lieux peu achalandés, afin de lui permettre de se dégourdir les jambes hors de sa chambre. Là encore, j’avais réussi à créer un lien sympathique avec ce pauvre homme, ce qui facilitait considérablement une tâche qui demandait une vigilance de chaque instant. Le plus triste était de sentir chez ce patient une solitude affective et sexuelle poignante et bien sûr, impossible à combler, qui faisait que toute forme de vie humaine, votre serviteur compris, aurait pu contribuer à son bonheur.
Et maintenant...
Cette dernière manifestation de détresse m’a amené à me demander comment elle aurait été abordée par des aides psychiatriques, donc du personnel disposant de la formation adéquate pour la prendre en considération. Je m’interrogeais du coup à savoir combien d’autres problèmes du genre restaient sans remède, dans l’éventualité même où ils étaient décelés. Tous les cas de patients psychiatrisés ne sont pas aussi pathétiques que ceux que je viens de décrire, mais la plupart demeurent difficiles.
 |
| La santé mentale peut devenir un véritable casse-tête... |
Tous autant que nous sommes, agents de service privé, infirmiers et infirmières, préposés ou médecins, nous restons plus ou moins des amateurs qui improvisons au mieux de nos compétences variables, bien conscients de nos limites devant les ravages trop fréquemment irréversibles des problèmes de santé mentale. Nous aussi, au même titre que les patients démunis qui nous sont référés, nous sommes les héritiers de la désinstitutionalisation, trop souvent liés à une succession hypothéquée à répartir parmi des morts en sursis.
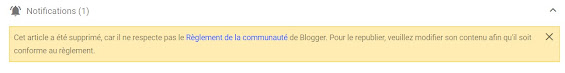



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire